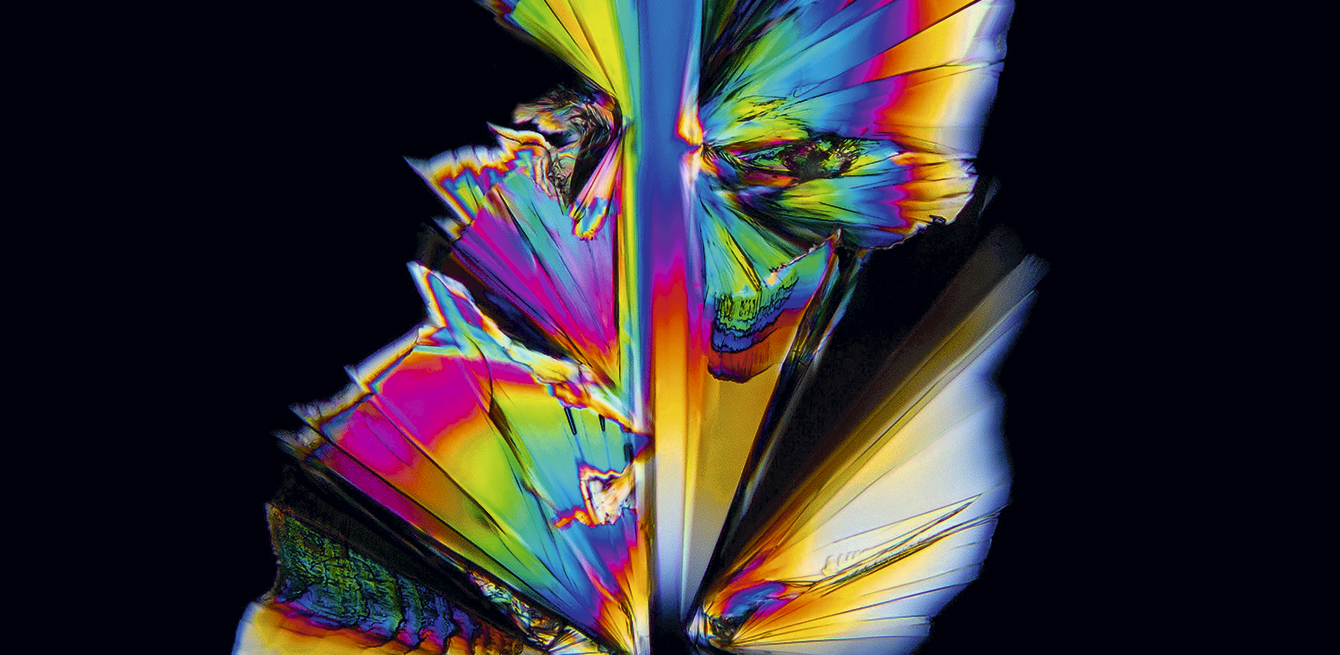
Les troubles mentaux sont fréquents et restent encore trop souvent soignés tardivement. La mise au point de méthodes de détection plus précises et de nouveaux traitements pourrait changer la donne. À cet égard, le développement de la recherche est crucial.
Entre 85 et 100 milliards, c’est le nombre de neurones que contient notre cerveau. Chacune de ces cellules est connectée à 10’000 autres, de quoi réaliser jusqu’à 100 trillions d’échanges d’informations simultanés. Un enchevêtrement aussi complexe que dynamique qui peut engendrer des dysfonctionnements, avec pour résultat des maladies psychiques comme Alzheimer, la dépression ou les troubles bipolaires.
Ces pathologies continuent à occuper une place à part dans la médecine, comme l’explique Jacques Gasser, chef du Département de psychiatrie du CHUV. Leur diagnostic demeure complexe et comprend toujours une part de subjectivité. Les médicaments disponibles présentent moins d’effets secondaires, mais leur action continue à atténuer les symptômes plutôt que de les soigner. Enfin, il n’existe pas encore de solutions pour prévenir le déclenchement de ces maladies. Une situation qui pourrait changer grâce à la découverte de biomarqueurs spécifiques aux maladies psychiques. Par biomarqueur, on entend une mesure des signaux générés par les différents processus biologiques du corps humain. C’est le principe de l’analyse du taux de cholestérol ou de la pression artérielle, signes avant-coureurs de maladies cardiaques.
Identifier des biomarqueurs dans un organe aussi complexe que le cerveau n’est pas une tâche aisée. Mais à l’instar de la neurobiologiste Kim Do Cuénod, les scientifiques estiment que leur découverte est cruciale (lire point 2). Ils permettront de garantir une prise en charge plus précoce des personnes à risque, d’établir des méthodes de diagnostic objectives, et de développer des médicaments mieux adaptés à chaque patient.

Lire l'interview de Jacques Gasser

Selon l’Observatoire suisse de la santé, 18% de la population suisse souffre de problèmes psychiques ressentis comme graves ou moyens. Mais malgré leur fréquence, ces maladies restent diagnostiquées tardivement. Un retard de prise en charge qui est particulièrement fréquent en cas de psychoses: «La schizophrénie est souvent diagnostiquée deux ans après le déclenchement des premiers symptômes, un délai qui peut atteindre dix ans pour les troubles bipolaires, explique ainsi Philippe Conus, chef du Service de psychiatrie générale au CHUV. Or, plusieurs études ont montré que plus le temps entre le début de la maladie et les traitements est long, moins l’évolution des patients est bonne.»
Les psychoses se déclarent en général vers la fin de l’adolescence et au début de l’âge adulte, une phase critique de la vie.
D’où l’idée de la mise en place du Programme traitement et intervention précoce dans les troubles psychotiques (TIPP), qui prend en charge chaque année une cinquantaine de patients entre 18 et 35 ans. Une approche qui soulève aussi des questions éthiques: jusqu’où peut-on aller dans cet effort? «Notre programme d’intervention précoce concerne des patients chez qui la maladie est déjà clairement constituée, insiste Philippe Conus. La question peut se poser chez des personnes à haut risque, mais ces dernières présentent en général d’autres problèmes qui justifient des soins: dépression, anxiété. Dans cette phase dite de prodrome, nous employons des stratégies très douces. On ne va pas donner des neuroleptiques, il s’agit surtout d’interventions psychosociales.»

Lire l'interview de Philippe Conus
La question de la détection précoce des troubles psychiques concerne aussi la population âgée, remarque Armin von Gunten, chef du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) au CHUV.
«Les personnes qui souffrent d’une pathologie démentielle, par exemple une maladie d’Alzheimer, manifestent aussi des troubles psychiques ou du comportement, comme l’anxiété ou la dépression, souvent à un stade précoce de la maladie.»
Agressivité verbale ou physique, agitation: ces troubles peuvent rapidement poser des difficultés majeures aux proches comme aux soignants. «Il s’agit d’un aspect négligé jusqu’ici par la recherche en matière d’Alzheimer, qui s’est concentrée sur la découverte de traitements qui modifient l’évolution de la maladie.»
C’est pourquoi Armin von Gunten et son équipe, en collaboration avec le neurobiologiste Ron Stoop, ont lancé voilà trois ans une étude pour identifier en amont la survenue de ces troubles chez les patients souffrant d’une maladie d’Alzheimer débutante. Une des pistes concerne le rôle de l’ocytocine en matière d’attachement personnel. «Cette hormone est une substance cruciale pour les contractions utérines lors de la naissance ou l’éjection du lait maternel. Elle influence aussi les liens sociaux entre une mère et son enfant et, plus tard, entre adultes.»
L’idée est que l’ocytocine pourrait améliorer les relations personnelles chez des patients présentant des troubles cognitifs. «L’étude a été menée sur un mode translation-nel. L’équipe de Ron Stoop a travaillé sur des modèles animaux. Les résultats de ces efforts sont vérifiés dans un second temps auprès d’une cohorte de patients, dé-taille Armin von Gunten. Les analyses préliminaires de notre étude vont dans notre sens. Si elles se confirment, il faudra ensuite vérifier comment adapter les soins au profil d’attachement social de chaque patient.»

La recherche translationnelle, c’est aussi le cheval de bataille de Kim Do Cuénod, cheffe du Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV, qui vient d’être désignée lauréate 2018 du prestigieux «Outstanding Basic Science Award», un prix décerné tous les deux ans par la Société internationale de recherche sur la schizophrénie (SIRS). Depuis une quinzaine d’années, la neurobiologiste et son équipe collaborent avec les psychiatres du CHUV pour mieux comprendre la schizophrénie. «Jusqu’ici, les neurosciences étaient le plus souvent consacrées à de la recherche fondamentale, avec des résultats difficilement transposables à l’être humain, remarque Philippe Conus. Avec Kim Do Cuénod, nous voulons résoudre des questions cliniques en nourrissant les observations faites chez l’homme par celles faites chez l’animal et réciproquement. Il s’agit vraiment d’un travail circulaire.»

Kim Do Cuénod, lauréate 2018 du prestigieux «Outstanding Basic Science Award», un prix décerné tous les deux ans par la Société internationale de recherche sur la schizophrénie (SIRS).
Une première étude a mis en évidence un déficit du système antioxydant dans le cerveau des patients schizophrènes. Après avoir caractérisé les mécanismes chez les modèles expérimentaux, les chercheurs lausannois se sont associés à des scientifiques de l’Université de Harvard pour étudier, dans la phase débutante de la psychose, les effets de la N-acétylcystéine (NAC), un médicament antioxydant générique. «Les résultats sont très prometteurs, souligne Kim Do Cuénod. Pour qu’une intervention précoce soit possible, nous avons besoin de biomarqueurs permettant de détecter les personnes à risque. Or, nous avons pu observer que la NAC améliore les fonctions neurocognitives chez un sous-groupe de patients qui présentent un taux d’oxydation élevé dans le sang.»
L’étude montre par ailleurs que le médicament améliore la connectivité structurelle et fonctionnelle du cerveau de ces patients. Des progrès que les chercheurs ont pu ensuite mesurer via l’électroencéphalographie (une méthode d’analyse qui mesure l’activité électrique du cerveau ndlr). «Ces conclusions valident notre approche de traitement basé sur les biomarqueurs.»
La prochaine étape va consister à vérifier les effets de la NAC auprès d’un groupe plus important. «Notre étude a porté sur une cohorte de 60 patients. Il faudrait pouvoir valider ces résultats sur un plus grand nombre de patients, ce qui coûte très cher. De plus, il faudrait pouvoir identifier des cibles plus spécifiques et les traiter. Notre recherche est donc un travail qui s’inscrit dans la durée. Une partie de mon temps est d’ailleurs consacrée à la recherche de fonds, notamment via la fondation Alamaya.»

En parallèle à l’alliance nouée avec les neuroscientifiques depuis une quinzaine d’années, les soignants en psychiatrie ont aussi revu leur relation aux familles des malades. «Auparavant, elles étaient le plus souvent considérées comme faisant partie des problèmes du patient, explique Roland Philippoz, infirmier chef, responsable des soins au Service de psychiatrie générale du CHUV.»
«Voir les proches dans un contexte de partenariat, reconnaître leurs souffrances et leurs difficultés a été un changement fort, pas évident à instaurer.»
Aux premiers groupes de parole au sein de l’hôpital et de l’ambulatoire ont succédé des associations de soutien, qui réunissent parents ou proches de patients psychotiques, bipolaires ou borderline. «L’idée essentielle qui anime ces démarches est de développer une communauté, pour que les gens puissent aller les uns vers les autres et mettre en mots ce qu’ils vivent», détaille Catherine Reymond-Wolfer, infirmière clinicienne au CHUV et membre du comité de L’îlot, une association lausannoise de proches de malades psychiques.
Des groupements qui peuvent aussi servir à restaurer la confiance entre parents et soignants. «Il y a des pères ou des mères qui ont subi des violences physiques ou psychologiques de la part de leur enfant pendant des mois ou des années avant qu’une intervention ait lieu. C’est devenu trop, ils ne veulent plus rien savoir, constate Roland Philippoz. Appréhender la maladie en étant accueillis par des proches d’autres patients est parfois plus simple.»

Lire le témoignage d'Anne Leroy
Autre changement majeur initié cette année: un projet pilote qui porte son attention sur les enfants de malades psychiques, lancé par Christel Vaudan et Charlène Tripalo, respectivement psychologue et infirmière au Département de psychiatrie du CHUV. Après la mise en place d’un espace de jeu et de rencontre au sein de l’hôpital de Cery, pour que les enfants puissent voir leur parent hospitalisé, et la création d’un poste de délégué aux proches, cette initiative intitulée Famille+ vise à intervenir auprès des patients pour aborder leur parentalité. Selon une étude récente menée à Winterthour,près de 22% des personnes traitées pour des maladies psychiques ont au moins un enfant mineur.
«Jusqu’ici, cette question n’était pas posée de manière systématique, précise Roland Philippoz. Le but n’est pas de soupçonner ces enfants de présenter des risques et de pratiquer un dépistage, mais plutôt de prendre en compte leurs souffrances en raison des mystères liés à la maladie de leur parent. D’où l’idée de passer par cette porte de la parentalité pour communiquer avec les enfants, pour autant que les patients l’acceptent.»

Lire le témoignage de Blaise Rochat
Les soignants sont vite confrontés aux limites du secret médical. C’est d’ailleurs l’une des thématiques mises en avant dans une série d’événements organisés cette année par le Service de psychiatrie générale. «D’un côté, les patients ne veulent souvent pas que nous parlions de leur situation, et de l’autre les proches se plaignent d’être tenus à l’écart. Développer une alliance sans pouvoir aborder les questions importantes reste très compliqué. La négociation avec la personne hospitalisée est indispensable pour débloquer la situation.»
L’effort de sensibilisation vise plus particulièrement les soignants. Dans le service, la moyenne d’âge des équipes est de 29 ans; la plupart n’ont pas encore d’enfants. «Nous voulons favoriser un regard intergénérationnel, de manière à ne pas stigmatiser les parents comme des ‘gens qui rendent fous’, dit Roland Philippoz. Quand on est soi-même parent, on perçoit plus facilement les difficultés et les ressources qu’il faut mobiliser pour soutenir quelqu’un qui cause tant de soucis.»
Plus connue sous son nom commercial Prozac, cette substance découverte en 1974 est utilisée dans le traitement de la dépression.
Zoom sur cinq projets de recherche menés au sein du Département de psychiatrie du CHUV.





Le nombre de personnes touchées par les maladies psychiques
en Suisse.
/
La proportion de jeunes souffrant
de troubles psychiques.
/
Nombre d’axes de recherche au sein du Département de psychiatrie
du CHUV: neurosciences, psychothérapie, sciences humaines, santé publique et épidémiologie.
Hippocrate, célèbre médecin de la Grèce antique, cherchait déjà un remède à ce mal qu’il nommait mélancolie. Elle se caractérise tant par des manifestations physiques que psychiques: fatigue inhabituelle, trouble du sommeil, de l’appétit ou de la libido, sentiment perpétuel de tristesse ou encore présence constante d’idées noires et perte de l’estime de soi. La dépression demeure plus que jamais un problème de santé publique majeur, dont le coût annuel en Suisse est estimé à plus de 10 milliards de francs. Ainsi, près de 25% de la population helvétique souffrira au moins une fois au cours de sa vie d’une dépression sévère.
Souvent utilisé à tort pour désigner les troubles de la personnalité multiple, le terme de schizophrénie vient du grec ancien skizein (fendre) et phren (pensée). Il s’agit d’une maladie psychique qui se déclare en général chez le jeune adulte. Elle se caractérise en premier lieu par un repli sur soi et une perte de contact avec la réalité. Dans sa phase aiguë, cette psychose provoque des hallucinations auditives qui peuvent être particulièrement troublantes pour le malade. Les facteurs liés à l’apparition d’une pathologie schizophrénique sont multiples: sociaux, psychologiques ou génétiques. Les causes de la maladie restent cependant encore mal comprises, rendant parfois compliqué un diagnostic précis.
Passer d’une intense euphorie à une profonde dépression de façon cyclique: c’est ce que vivent les personnes souffrant de troubles bipolaires. C’est le médecin allemand Emil Kraepelin qui énonce le premier, en 1899, la conception moderne de cette maladie, autrefois appelée psychose maniaco-dépressive. Lors de la phase dépressive, le patient se sent triste et fatigué, et montre un désintérêt pour les activités du quotidien. À l’inverse, lors de la phase maniaque, il va déborder d’énergie et de paroles passant du coq-à-l’âne, et peut aussi souffrir d’idées délirantes ou d’hallucinations.
On regroupe sous ce terme les différentes perturbations du caractère d’une personne. Elles peuvent concerner les pensées, les sentiments ou les relations interpersonnelles d’un individu et engendrent des problèmes au niveau de son fonctionnement social ou un état de souffrance. La cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), outil de référence en matière de psychiatrie, distingue trois grandes catégories: les troubles excentriques, les troubles dramatiques, émotionnels ou erratiques, ainsi que les troubles anxieux et craintifs.
L’image la plus souvent associée au trouble obsessionnel compulsif (TOC) est celle d’un lavage de main répétitif. Relevant des pathologies de l’anxiété, il se caractérise par des pensées récurrentes (obsessions) que le malade cherche à dissiper par des rituels particuliers (compulsions). Le TOC, qui apparaît pendant l’enfance ou l’âge adulte, est considéré comme la 4e maladie mentale la plus fréquente dans le monde, et il touche autant les hommes que les femmes. Ayant une composante neurologique, le trouble obsessionnel compulsif peut résulter d’infections touchant le système nerveux central, comme une encéphalite. D’autres maladies neuro-dégénératives peuvent être également associées à l’apparition de la pathologie.